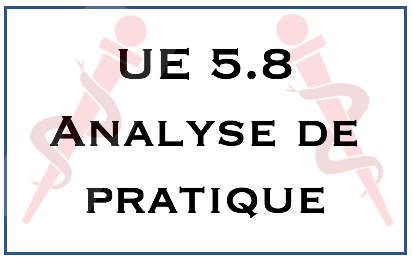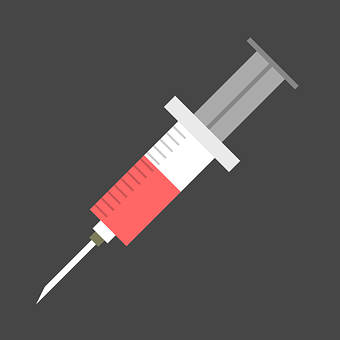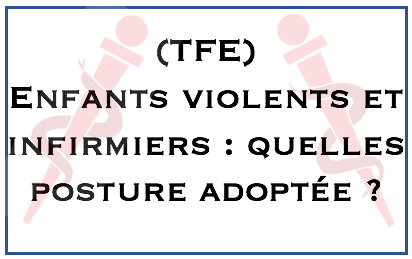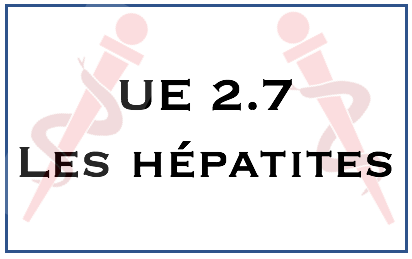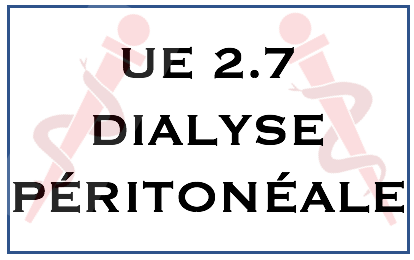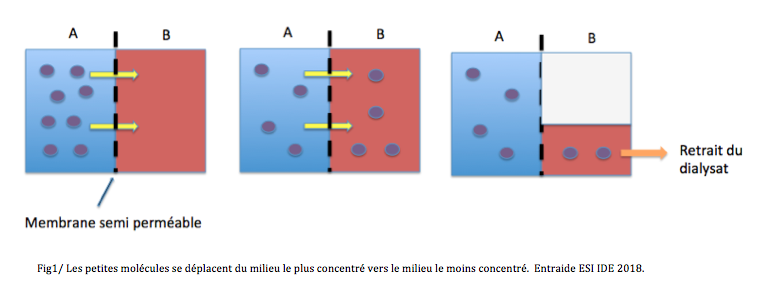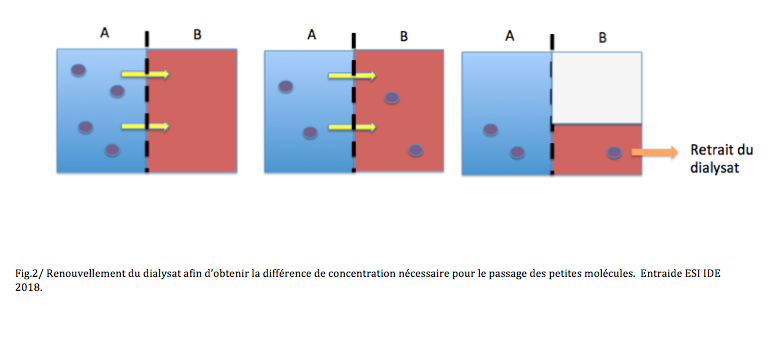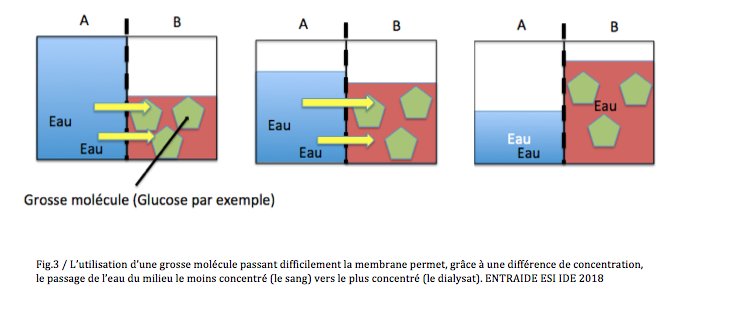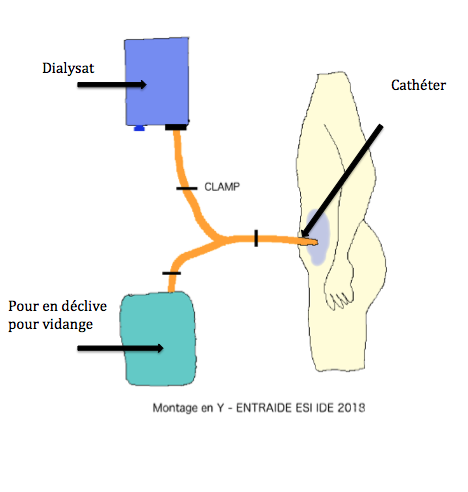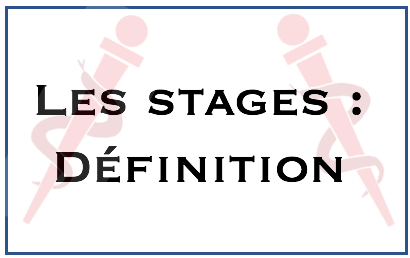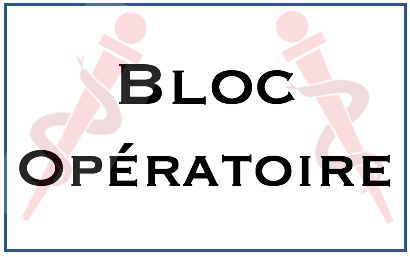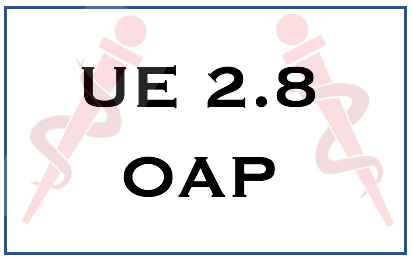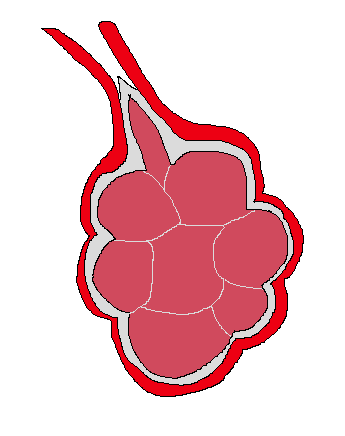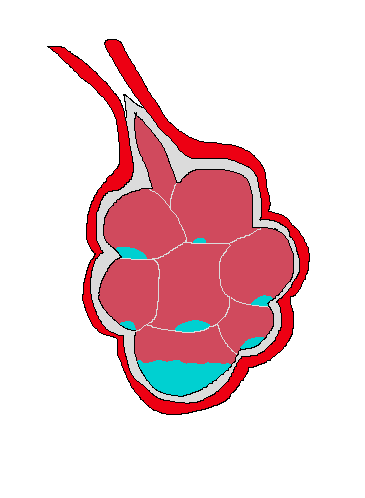L’analyse de pratique professionnelle permet à l’étudiant de se mettre en posture réflexive.

1- Objectif
L’objectif de l’analyse de pratique professionnelle (APP) est d’amener l’étudiant à réfléchir et organiser ses idées en vue de la réalisation d’un travail de fin d’études en dernière année. Chaque situation présentée peut-être potentiellement une introduction à votre TFE (situation de départ, questionnement naïf et question de départ). C’est pourquoi, il est important de comprendre l’enjeu de l’analyse de pratique professionnelle dès le début de la formation. Plus vous pratiquez, plus le schéma sera facile à reproduire en troisième année. La validation des analyses de pratiques professionnelles fait partie des éléments qui permettent l’attribution ou non des ECTS relatifs au stage (UE 5.8). Ceci est développé dans l’article 32 de l’Arrêté du 31 Juillet 2009.
2- Contenu
L’analyse de pratique doit se décliner en plusieurs parties :
– Tout d’abord, vous devez décrire objectivement une situation rencontrée ou une activité vue ou réalisée. N’hésitez pas a présenter au préalable le service, de façon succincte, pour que le lecteur comprenne un minimum le contexte. Pensez à bien conserver l’anonymat des patients évoqués et des différents professionnels.
– Retirez le superflu, ne gardez que ce qui a un réel intérêt pour le questionnement (cela vous permettra d’être concis lors de la rédaction de la situation de départ de votre TFE).
– Ensuite viennent les observations et étonnements. Vous pouvez les classer en fonctions de différents points ou les regrouper par thèmes. C’est vraiment ici que vous expliquez ce que vous avez ressenti, que vous décrivez vos émotions, ce qui vous a posé problème, interrogé, bloqué…
C’est une partie importante centrée sur le questionnement : qu’est-ce-que j’ai fait ? qu’est-ce-que je n’ai pas fait ? Qu’est-ce-que j’aurai du/pu faire ? Pourquoi ?
– Toutes ces questions, dites « naïves » , qui découlent de votre situation pourront vous orienter pour trouver une question de départ à votre TFE, plus complète, afin de traiter l’ensemble des éléments et thèmes que vous voulez aborder.
– Enfin, la dernière partie s’oriente sur les difficultés rencontrées et points à approfondir. Qu’est-ce-qui vous a manqué (connaissances théoriques ou pratiques, technique, expérience, maturité…)? Qu’est-ce-que vous pourriez améliorer dans une situation semblable dans votre carrière, par la suite ?
Cette partie est vraiment la remise en question du soignant : c’est un peu le bilan pour ne plus être pris au dépourvu si la situation se représente.
– Face à chaque difficulté dans le soin, il est important que le soignant se remette en question. En posant par écrit son raisonnement, le soignant développe sa curiosité professionnelle et intellectuelle, et facilite ainsi les raisonnement futur.
– Selon les IFSI, il se peut qu’on vous demande en fin d’analyse si vous vous sentez suffisamment autonome sur l’ensemble de ces activités pour les assurer seul. C’est juste un moyen pour vous de faire un bilan d’acquisition de compétences. Ce n’est pas obligatoire mais cela vous permettra de vous situer dans les attentes des soignants.
3- Exemple (une des façons de faire)
| Contexte | Décrivez ici le service où vous êtes en stage, le lieu en préservant l’anonymat, le moment et votre avancée dans la formation |
| Qui | Décrivez ici les protagonistes principaux : – Patient : âge, motif d’hospitalisation/consultation, environnement, traitements significatifs – Entourage du patient (si utile) – Equipe pluridisciplinaire (IDE, AS, Interne, Médecin, Kiné, ESI,…) |
| Cadre législatif (optionnel) | Notez ici les textes de loi en référence avec votre situation |
| Compétence(s) mobilisée(s) | Notez ici les compétences mobilisées par votre situation |
| Déroulement de l’activité, de la situation rencontrée | Décrivez ici la situation ou l’activité vécue. Pour les activités, détaillez pourquoi ; le déroulement chronologique factuel, et toutes les informations que vous jugez nécessaires, les modalités de réalisation (procédure, technique, matériel…). Notez également les éléments qui vont préciser vos limites d’actions et de prises de décisions/réactions. |
| Connaissances mobilisées | Notez ici vos savoirs théoriques, pratiques, relationnels et méthodologiques mobilisés. |
| Observations et étonnements | Posez-vous ici toutes les questions qui vous sont venues suite à cette situation, tous les étonnements et toutes les informations que vous jugerez nécessaires. |
| Difficultés rencontrées, points à approfondir et auto-évaluation | Expliquez ici tout ce qui a pu vous gêner pour la réalisation et le déroulement de la situation, et vos lacunes |
| Mesure(s) corrective(s) envisagée(s) | Inscrivez ici ce que vous mettriez en oeuvre, ce que vous changeriez si la situation se représentait à vous. Que modifieriez-vous dans votre pratique quotidienne pour ne pas être confronté de nouveau à ces difficultés. |

SOURCES
- Cours personnels IFSI
- Portfolio
- Recueil des principaux textes relatifs à la formation préparant au diplôme d’Etat et à l’exercice de la profession.